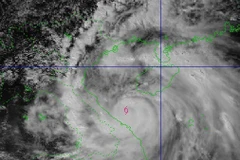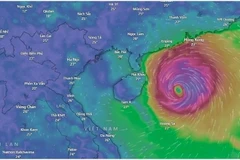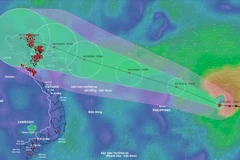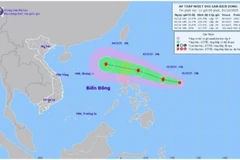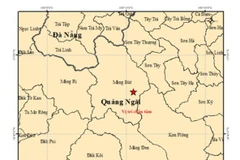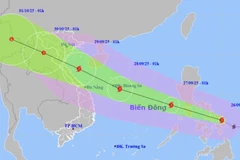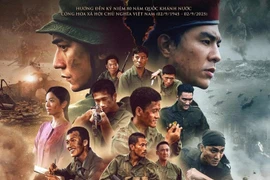Hanoi (VNA) – Confronté aux défis climatiques, le delta du Mékong a amorcé sa transition écologique. Cette stratégie proactive vise à préserver ses écosystèmes et à garantir la résilience de ses communautés.
En première ligne face au changement climatique, le delta du Mékong voit ses écosystèmes bouleversés. Pour ses 20 millions d’habitants, les menaces ne sont plus théoriques ; elles sont une réalité quotidienne qui les contraint à s’adapter pour ne pas tout perdre.
Ennemis silencieux
L’érosion côtière et fluviale se produit à un rythme alarmant. Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), depuis 2016, le Delta a connu 812 phénomènes d’érosion sur plus de 1.210 km de berges. Parmi eux, 688 concernent les berges de rivières et 124 le littoral, avec une perte annuelle moyenne de 15 à 20 m, avec des pics allant jusqu’à 40 - 50 m dans certaines sections.
Derrière ces chiffres, il y a la douleur et le désarroi de milliers de familles. Un exemple poignant est la terrible érosion survenue début mai 2025 dans le quartier de Thoi Long, ville de Cân Tho. En une seule nuit, une route rurale, à peine rénovée, a disparu, plongeant les habitants dans un effroi profond.
Van Thi Be Ba, résidente locale, se souvient avec angoisse : “Je ne pouvais pas dormir le soir... Je suis restée là, à regarder le sable s’effondrer petit à petit. Mon mari et moi avons ouvert la porte, nous nous sommes tenus là avec une lampe de poche et avons vu tout s’affaisser peu à peu. C’était terrifiant”.
Outre les terres et les maisons, l’érosion entrave des axes de transport vitaux, impactant la vie de millions de personnes. Par ailleurs, la région perd environ 250 ha de mangroves chaque année, pourtant considérées comme un “bouclier” naturel protégeant le littoral et son écosystème.
Si l’érosion est une attaque frontale, la sécheresse et l’intrusion saline sont des ennemis silencieux. Selon Tang Quôc Chinh, du Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles, l’intrusion saline dans le Delta du Mékong s’intensifie, arrivant 1 à 1,5 mois plus tôt et pénétrant jusqu’à 80 à 90 km dans les terres, contre une moyenne de 30 à 35 km auparavant. Les sécheresses historiques de 2015-2016 et 2019-2020 ont touché des centaines de milliers d’hectares de terres agricoles et privé des milliers de foyers d’eau potable.

Le Pr.- Dr. Lê Anh Tuân, ancien directeur adjoint de l’Institut de recherche sur le changement climatique de l’Université de Cân Tho, souligne une série d’autres défis : la montée du niveau de la mer, les barrages hydroélectriques en amont, la dérivation du Mékong, la dégradation de la qualité de l’eau, les changements d’affectation des terres et les conflits liés à l’utilisation de l’eau. Tous ces facteurs perturbent l’écosystème, menaçant directement la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des habitants, les poussant à quitter leur village natal.
Transition et adaptation
Face à la complexité du changement climatique, le delta du Mékong cherche activement des solutions, qu’il s’agisse de politiques gouvernementales ou d’initiatives locales, pour transformer les défis en moteurs de développement durable.
La philosophie “vivre avec et s’adapter” est devenue la ligne directrice des actions des habitants du delta. Plutôt que de s’y opposer, ils apprennent à “suivre le cours de la nature”. De nombreux foyers ont acquis de l’expérience en termes de “vie en harmonie” avec les impacts naturels.
Nguyên Van Tâm, habitant de l’île de Long Tri, quartier de Long Duc, province de Vinh Long, affirme : “Ce n’est pas l’eau salée qui est mauvaise pour nous ni l’eau douce qui est toujours bénéfique. Tout dépend de la manière dont on l’utilise, de la culture ou de l’élevage que l’on pratique”.

Cette mentalité a été le moteur de modèles agricoles efficaces et adaptés. Les modèles crevette-riz, riz-poisson, la riziculture bio ou l’irrigation économe en eau démontrent une nouvelle vitalité dans la région.
“Les agriculteurs participent à de nombreux programmes de formation, ils maîtrisent les techniques de production et ont adopté le transfert de technologie. Ils s’efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de respecter les normes VietGap pour garantir la sécurité des produits agricoles et la préservation de l’environnement”, confie Dô Duy Nguyên, agriculteur dans la commune de Tân Hiêp, province voisine d’An Giang.
Actions concrètes
Face aux défis urgents, le gouvernement a ordonné l’élaboration d’un projet de prévention des catastrophes naturelles jusqu’en 2035, avec vision à l’horizon 2050. Ce projet se concentre sur la gestion de l’érosion côtière et fluviale, ainsi que sur le déplacement des populations vivant dans les zones à risque.
Cependant, des experts comme le Pr.- Dr. Trân Thuc, ancien directeur de l’Institut des sciences de la météorologie, de l’hydrologie et du changement climatique, estiment que les solutions purement “rigides” pourraient s’avérer contre-productives. Il serait préférable d’adopter une approche intégrée, combinant la construction de digues et de réservoirs avec des solutions basées sur la nature, comme la plantation de mangroves et la restitution des espaces pour les inondations et les alluvions.
“Il existe des similitudes entre les Pays-Bas et le delta du Mékong, tous deux étant soumis à l’influence de la mer. Cependant, la différence est que le territoire néerlandais est petit, tandis que celui du Delta du Mékong est vaste. Par conséquent, l’apprentissage du modèle néerlandais doit être sélectif. Actuellement, les ouvrages de prévention des catastrophes dans le Delta du Mékong sont principalement des structures rigides. Les solutions non structurelles consistent à lever les obstacles pour redonner de l’espace aux lits des rivières et permettre aux alluvions de revenir dans le delta”, précise-t-il.
Lê Duc Thinh, directeur général du Département de l’économie coopérative et du développement rural, considère que la sensibilisation des populations au changement climatique est une action nécessaire pour s’adapter de manière globale, à travers les processus de production et la diversification des cultures. “Nous avons beaucoup investi dans le felta du Mékong, notamment dans les infrastructures, mais nous devons veiller à ce que les mesures non structurelles soient également efficaces et bien intégrées. Les deux doivent aller de pair”, dit-il.
Lors de la 26e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement vietnamien a réaffirmé son engagement à atteindre l’objectif “zéro émission nette” d’ici 2050. Des mesures importantes comme la Loi sur la protection de l’environnement de 2020 et les projets de lutte contre la sécheresse et le sel ont créé un cadre juridique et un mécanisme permettant aux localités, aux entreprises et aux habitants du delta du Mékong de s’adapter de manière proactive.
Un des projets stratégiques est le “développement durable d’un million d’hectares de rizières de haute qualité et à faibles émissions”. Le Dr. Nguyên Tuân Quang, directeur adjoint du Département du changement climatique, fait savoir que : “Selon les calculs de la Banque mondiale, si nous appliquons pleinement les mesures techniques, nous pouvons générer entre 5 et 6 millions de tonnes de crédits carbone par an, ce qui représente une ressource extrêmement importante”.
Grâce à cette implication coordonnée et proactive, le delta du Mékong transforme la menace du changement climatique, non pas en une simple menace, mais en une opportunité de repenser son développement. C’est un “nouvel élan” qui permettra au “grenier à riz, à produit aquatiques et à fruits” de devenir un modèle de développement vert et durable dans la région et dans le monde. – CVN/VNA