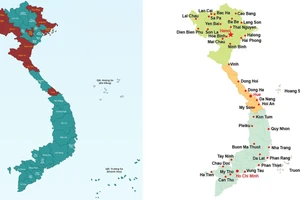Pour les Ê dê, lemariage répond à des rituels bien particuliers totalement opposés à ceuxde la majorité Kinh. Ainsi, c’est la jeune fille qui cherche son futurépoux, les enfants portent le nom de leur mère, et l’héritage revienttoujours à la benjamine de la famille.
Quand ils sont enâge de se marier, les jeunes Ê dê se rencontrent le plus souvent lorsdes fêtes de village, des cérémonies religieuses ou pendant lesrécoltes. C’est en fait le moment idéal pour les jeunes filles detrouver un homme susceptible de devenir leur futur mari. Il leurappartient ensuite de demander à leurs parents si elles peuventl’épouser. Dans ce système familial matrilinéaire, l’homme est donc dansl’attente, et ne peut prendre une telle initiative.
La demande en mariage
Dansla tradition de cette minorité ethnique, le mariage doit passer partrois étapes immuables : la demande officielle, le «défi», et l’unionproprement dite. L’accord des deux familles est indispensable. Dès lors,les parents de la fiancée devront verser une dot au futur mari. Danscertains cas, ils imposent ce choix à leur fille. La dot sera alors plusélevée.
Selon A Ê No, 70 ans, doyen du village de KoTam, commune d’Êa Tu, de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak (hautsplateaux du Centre), la famille de la fille doit couvrir tous les fraisliés au mariage. Si l’homme accepte la demande, la famille de la filleorganisera un «cortège» uniquement composé de proches, jusque chez lui,en le prévenant à l’avance.
Selon les traditions, celuiqui parlera au nom de la famille sera un oncle ou un représentantrespecté de ses membres. Ils offriront alors deux cadeaux symboliquespour marquer cette première rencontre : un coq bien cuit et du rizgluant soigneusement préparé. Selon le doyen, le premier est un symbolede bienvenue, tel le plateau de bétel et de noix d’arec dans le mariagedes Kinh (ethnie majoritaire du Vietnam). Le riz gluant, quant à lui,représente, du fait de sa texture, la force d’un couple qu’on ne pourraséparer.
Sur place, la famille de l’homme fait semblantde ne pas être au courant de cette rencontre et demandetraditionnellement à ses visiteurs la raison de leur venue. Tout lemonde discute alors jusqu’à obtenir un accord sur le mariage. Les jeunesfiancés doivent ensuite déclarer publiquement leur amour réciproque ets’échanger deux anneaux. En cuivre ou en or, ces derniers sontconsidérés comme le témoignage des promesses formulées par le futurcouple.
Alors que les deux familles sont maintenantsatisfaites, celle du futur mari va réclamer sa dot. Habituellement,elle demande un bœuf ou un buffle, une somme d’argent et de l’alcool. Sila famille de la fille répond au «défi» de celle du mari, la cérémoniesera célébrée selon la date fixée par l’accord préalable. En revanche,si elle n’est pas capable de payer tous les frais exigés, le mariagesera différé. D’autre part, la cérémonie ne pourra avoir lieu que si lafamille de la fille apporte des preuves de sa richesse.
Le jour J
Lespremières étapes achevées et approuvées par les deux parties, lacérémonie pourra être organisée. Elle durera deux jours pendant lesquelson fera venir chanteurs et danseurs. On boira du ruou cân (alcool deriz à consommer avec un chalumeau de bambou) et les jeunes mariés s’enéchangeront un bol en écoutant les conseils de leurs parents. La famillede la fille tuera un bœuf et un cochon pour régaler les convives, et unrituel sera organisé pour «emmener» officiellement le mari dans lademeure de sa nouvelle épouse. Un maître de cérémonie, un entremetteur,ou le doyen du village priera les ancêtres pour que la vie du couplesoit heureuse et prospère, et que leurs enfants soient intelligents eten bonne santé. Les alliances portées par les époux seront offertes parles oncles de la mariée. Selon A Ê No, la présence du doyen est trèsimportante, il est témoin du mariage et devra gérer les disputes etconflits familiaux. Si l’un des deux époux est infidèle, ou s’ils seséparent pour des raisons irrecevables, il pourra les punir d’une lourdeamende d’une valeur de 5 à 40 millions de dôngs, soit en argent, soiten bœufs ou en buffles.
Les enfants portent le nom de leur mère
Bienloin des traditions Kinh, c’est le mari qui habite, une fois le mariagecélébré, dans la maison de la famille de sa femme (demeure commune oùtous les membres vivent ensemble). S’il veut voir ses parents, il doitlui demander la permission. De plus, lorsque l’épouse se rend autravail, il doit la suivre avec une hotte. La femme est bénéficiaire deplus de droits que son mari dans la prise de décisions. Si elle est labenjamine de sa fratrie, elle est responsable de ses parents, etl’héritière de la maison et des biens familiaux. Enfin, dans latradition des Ê dê, les enfants portent le nom de leur mère. - VNA

Hanoï révolutionnera ses transports avec une billetterie électronique dès septembre 2025
Après une phase pilote concluante, le lancement officiel du système de billetterie électronique pour les transports publics est programmé pour le 2 septembre 2025 à Hanoï. Ce système, conçu pour l'avenir, ira au-delà des simples transports en permettant diverses autres transactions, contribuant ainsi activement au développement des transports intelligents dans la ville.